Pour son travail, Eugène Delacroix trouvait l'inspiration dans La Tragédie d'Antoine et Cléopâtre de William Shakespeare et dépeint avec ce travail préparatoire la scène II de l'Acte IV. Les motivations de personnages de la pièce de Shakespeare deviennent alors les motivations des figures de Delacroix et la pièce ne se contente pas d'influencer le style du peintre, elle construit le tableau lui-même.
Lorsque l'on regarde Cléopâtre et le Paysan, nos yeux sont instantanément attirés par le magnifique visage pâle de la reine. Sa peau parfaite illumine la pièce dans laquelle est elle assise et sa bijouterie réverbère brillamment sa lumière. Des bijoux luxueux ornent son bras droit, son cou et sa couronne, renforcent le contraste de sa chair claire et éclairent sur sa position royale. Delacroix lui donne même presque un statut d'immortelle, de par son rayonnement et ses signes de richesse.
Un regard plus attentif sur le fardeau du paysan révèle l'image d'un serpent sortant du panier de feuilles de figues et de fruits et remontant vers la tête de la reine, entre la main musclée de l'homme et sa fourrure tachetée. La forme torturée du serpent semble être le seul mouvement du tableau et, associé avec ses nuances vertes et jaunes, en fait l'élément le plus réaliste de l'œuvre.
Une fois que l'on a remarqué la présence du serpent, la peinture prend une toute autre signification. Il devient alors évident que le visage de Cléopâtre est tourné vers le panier de figues et que son expression solennelle est une réaction à la vision du serpent. Néanmoins, le sourire du paysan semble accueillant et donne l'impression qu'il offre ce panier de figues à Cléopâtre.


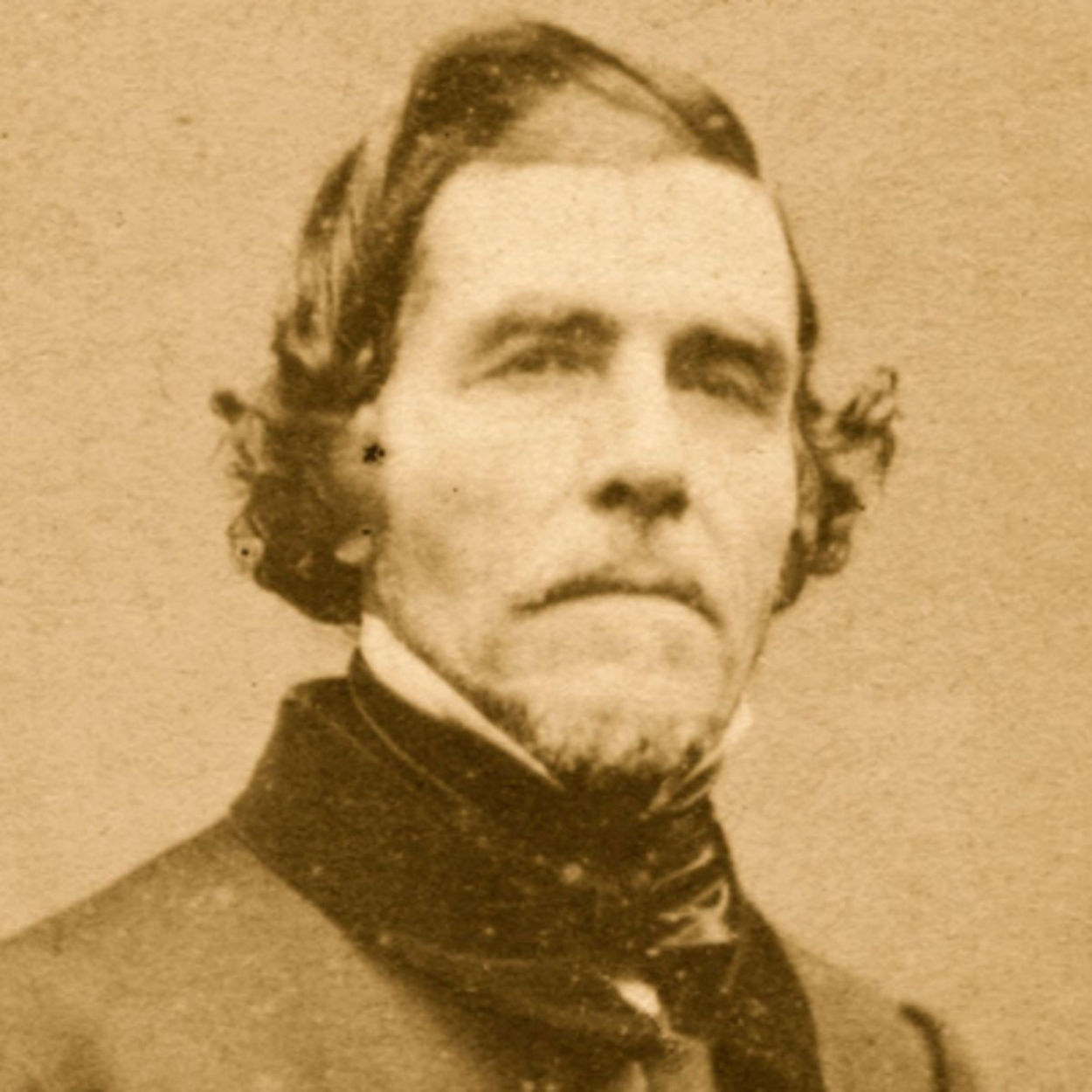 Eugène Delacroix
Eugène Delacroix